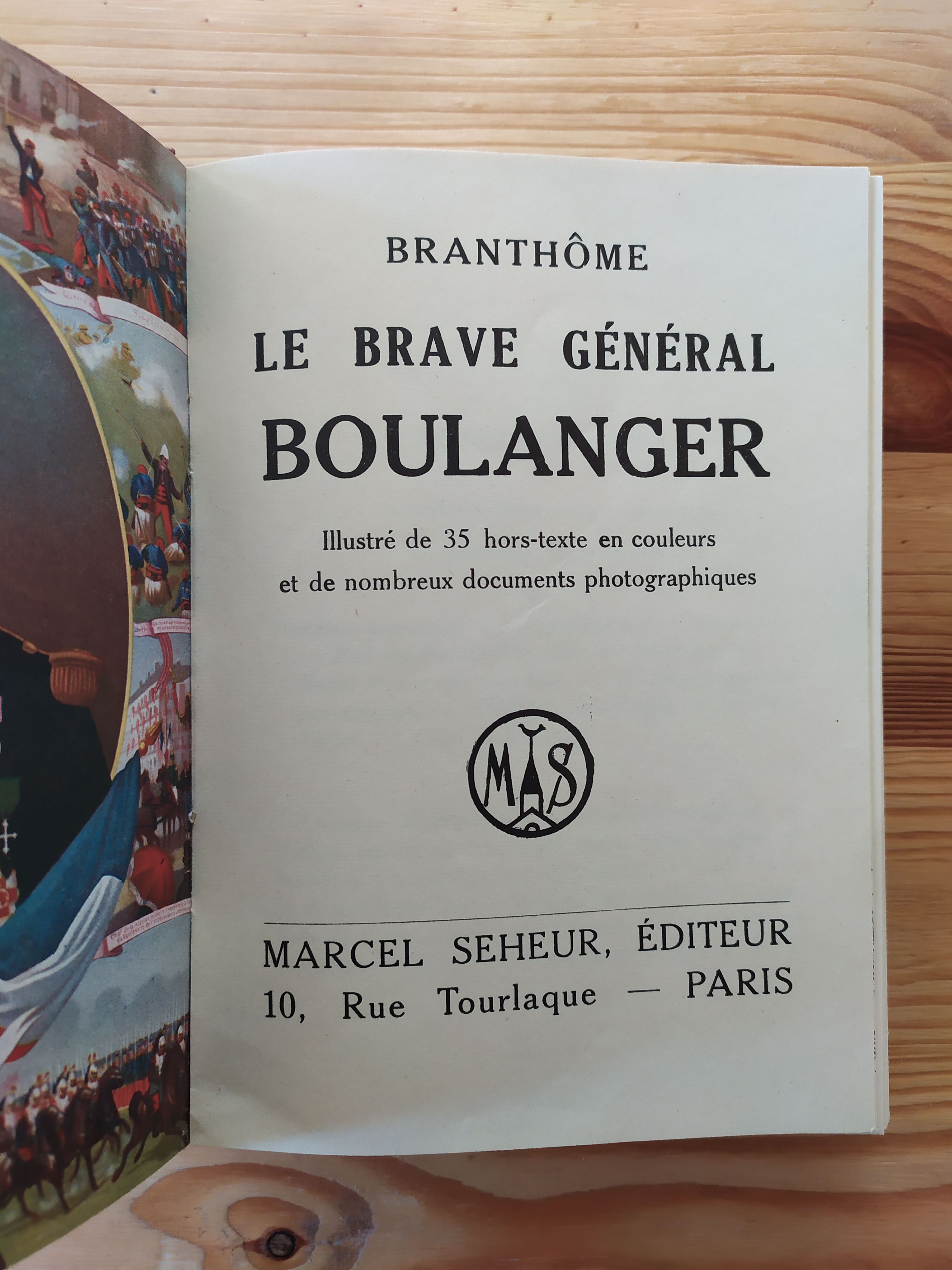Georges Ernest Jean-Marie Boulanger, fils d’un bourgeois breton et d’une aristocrate galloise, entre à Saint-Cyr, puis participe à plusieurs campagnes miitaires dans lesquelles il s’illustre, pour devenir, en 1880, le plus jeune général de l’armée française. Populaire parmi les troupes, il devient Ministre de la Guerre, en 1886, à l’instigation de Georges Clémenceau, avec lequel il avait suivi les cours du Lycée de Nantes. Très hostile a l’Allemagne et habitué des coups d’éclat contre la puissance ennemie, son implication dans une affaire d’espionnage non autorisé par l’État séduit les nationalistes (Maurice Barrès), faisant de lui le « Général Revanche ». Ses discours belliqueux, au centre desquels se trouvent la patrie et le peuple, servis par une prestance hors du commun mais aussi par les mesures qu’il fait adopter, accroissent encore sa popularité. Écarté du gouvernement en 1887, Il se trouve ainsi paradoxalement soutenu à la fois par les Bonapartistes, des Monarchistes (dont la Duchesse d’Uzès) et une partie de la gauche et l’extrême-gauche (dont Alfred Naquet), étant devenu de fait le porte-voix de tous ceux qui sont insatisfaits de l’ordre établi. Anti-parlementaire, virulent à l’encontre de la bourgeoisie au gouvernenement, Il propose alors en guise de programme la mise en place d’une Assemblée constituante et se trouve à la tête d’un véritable mouvement politique, pour l’essentiel centré autour de sa figure contestataire (le Boulangisme). Il parvient à présenter des candidats dans chaque département et entre lui-même à la Chambre en 1888. Le 27 janvier 1889, il se présente à Paris et remporte l’élection. Certains de ses soutiens, comme le radical Alfred Naquet, lui suggèrent alors de marcher sur l’Élysée et d’effectuer un coup d’État, ce qu’il se refuse à faire. Les cris des « Boulangistes » servent d’ailleurs de bruit de fond au roman Là-Bas, de Huÿsmans, écrit à ce moment.
À la suite, ayant commis plusieurs irrégularités, notamment dans le financement de ses campagnes ou par sa candidature à des élections pour lesquelles il ne pouvait être investi, Boulanger est accusé de complot contre la sûreté de l'État et menacé d'un ordre d'arrestation par le Ministre de l'Intérieur. Il choisit alors de quitter la France pour la Belgique et s'établit avec sa compagne à Bruxelles, à partir du 1er Avril 1889.
S'il s'attend à être rappelé pour un retour triomphal, à l'instar de Napoléon, les événements prennent une toute autre tournure. Le 14 août, le Sénat français, réuni en Haute Cour de justice, le condamne par contumace avec ses soutiens Rochefort et le comte Dillon, à la « déportation dans une enceinte fortifiée ». Dès lors, il ne peut revenir en France. Le gouvernement a fait interdire le cumul des candidatures aux élections législatives par la loi du 17 juillet 1889 : à celles de septembre 1889, les Boulangistes n'obtiennent plus que 72 élus (contre 366). C'est la fin du mouvement, hâtée par les poursuites lancées contre certains de ses soutiens, comme la Ligue des patriotes. Enfin, sa chère maîtresse, Marguerite de Bonnemains, meurt de la tuberculose le 16 juillet 1891. Isolé et ébranlé, Boulanger finit par se suicider sur le caveau familial, à Ixelles, le 30 septembre 1891.
Un volume in-12 dans un cartonnage amateur. Un des 3500 exemplaires non-numérotés du tirage unique. Plats de couverture conservés. Les marges d'origine ont été rognées à la reliure, avec quelques cahiers coupés légèrement de biais.